De la trace à la trame. La voie, lecture du développement urbain
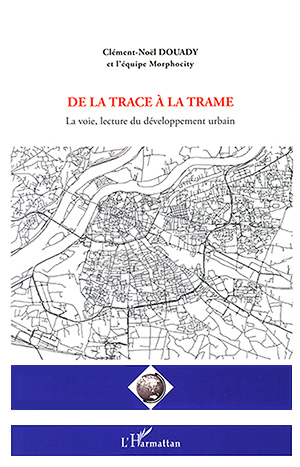 |
De la trace à la trame. La voie, lecture du développement urbain se présente comme un premier «essai» (p. 177) que l’équipe Morphocity consacre à l’avancée de son projet Modèles Numériques de Morphogénèse Viaire [1] (MoNuMoVi). Cet ouvrage pluridisciplinaire (archéogéographie, architecture, mathématiques, physique, urbanisme) cerne un objet qui n’est pas étranger à la géographie, à savoir la structuration et le développement d’espaces urbains, et la présentation s’appuie sur de nombreuses images de réseaux (103 des 255 pages que compte l’ouvrage sont composées d’images).
Le propos de cet ouvrage est d’expliciter et de justifier un programme de modélisation du développement de villes à partir de leur trame viaire. Comme l’indique le sous-titre: la voie, lecture du développement urbain, le concept central élaboré par l’équipe est celui de voie. Celle-ci est comprise comme une structure spatiale linéaire définie par des critères de continuité et d’alignement. Détachée de la notion de rue, elle correspond à des ensembles plus ou moins étendus et diffus d’alignements continus, qu’interrompent des intersections. Ainsi géométriquement définie, la voie est présentée comme un opérateur d’analyses des formes urbaines et de leurs évolutions. Cette modélisation mathématique est pensée pour être appliquée à des espaces urbains de toute dimension et de tout contexte géographique. Le projet MoNuMoVi met l’accent sur une approche commune de villes européennes et chinoises.
L’ouvrage est organisé en deux parties. À une première partie qui répertorie les formes observables des réseaux viaires, séparément et par combinaison, succède la présentation d’un ensemble de regards réflexifs et méthodologiques concernant les possibilités et l’intérêt d’une démarche de modélisation, puis un ensemble de cas de villes sur lesquels cette démarche trouve à s’aiguiser. Outre la présentation de la modélisation (contributions de Stéphane Douady et Claire Lagesse), cette deuxième partie propose une conceptualisation de la notion de trace (contribution de Patricia Bordin). Cette notion sur laquelle nous reviendrons, correspond ici à «ce qui reste dans ce qui change» (p. 172). Elle paraît appropriée pour une recherche qui vise à comprendre le rôle de la structure viaire d’une ville dans son développement, cette structure pouvant être a priori appréhendée comme durable. Si la mise en œuvre de la modélisation nécessite de numériser pour chaque ville considérée des documents d’époque diverse, la démarche vise essentiellement la prospective et le conseil. L’idée sous-jacente est que les voies d’aujourd’hui ne font pas seulement trace d’un fonctionnement passé, mais qu’elles conditionnent le fonctionnement urbain futur dans des périmètres élargis.
Un angle de lecture possible pour cet ouvrage est celui de l’interdisciplinarité. Affichée par le coordonnateur de l’ouvrage, elle est mise à l’épreuve de cette première publication d’équipe. On peut aborder cette question à partir de deux entrées:
- celle de l’interdisciplinarité interne: quelles articulations observe-t-on entre les spécialités représentées dans l’ouvrage?
- celle de l’interdisciplinarité externe: quel usage est-il fait de disciplines non représentées dans l’équipe bien que présentes dans l’ouvrage?
Parmi les spécialités représentées, l’archéogéographie et la géomatique sont particulièrement saillantes par la cohérence interne de leurs discours. Leurs spécialistes y font référence à des travaux antérieurs et installent ou rappellent des débats propres à leur discipline. Pour la géomatique, le débat concerne la manière de prendre en compte la géométrie des voies et la pratique des usagers dans la modélisation des réseaux. Pour l’archéogéographie, les textes rappellent l’enjeu d’une relativisation de la fixité des formes, au profit de l’analyse des dynamiques qui les recomposent dans leurs milieux successifs. L’ouvrage donne ainsi l’occasion d’observer le «frottement» de deux spécialités, dans leur approche des réseaux, particulièrement par les conceptualisations assez différentes qu’elles offrent de la notion de trace.
La trace est abordée par les géomaticiens de l’équipe à partir de la modélisation des changements dans les réseaux viaires. Articulée au concept de voie, elle se définit comme une composante spatiale conservée, alors que l’emprise au sol peut être modifiée, par exemple avec la mise en fonctionnement d’une nouvelle route. La trace renvoie par conséquent à la pérennité d’une structure spatiale invisible aux acteurs et elle est agissante en ce qu’elle contribue à structurer le développement urbain. La notion de trace est utilisée par les archéogéographes pour désigner l’attribution d’une forme contemporaine visible (le tracé d’un chemin, la trame d’un parcellaire) à un ou plusieurs modes combinés et successifs de structuration de l’espace. Elle est le produit du travail d’un spécialiste de l’histoire des paysages. En aucun cas elle n'a d'action concrète, en dehors de débats disciplinaires. Et si elle est tout aussi invisible que la trace des géomaticiens, elle peut néanmoins être référée à des modelés et des tracés matériels. Ce qui n’est pas le cas de la première qui est d’une nature purement spatiale, c’est-à-dire relationnelle. L’intérêt de l’ouvrage est de nous laisser dans l’incertitude sur ce que l’équipe construira à partir de ces deux topoï disciplinaires (Berthelot, 2012). Le travail interdisciplinaire «atténue les barrières» (présentation): le partage manifeste d’une conception relationnelle de l’espace et d’une approche multiscalaire y contribue. Mais on a bien, d’un côté, un programme d’abstraction des structures spatiales de leur contexte social, et de l’autre, un programme d’étude des transformations et des transmissions par lesquelles, d’un contexte socio-historique à l’autre, des réseaux se trouvent modifiés.
Parmi les disciplines invoquées dans l’ouvrage sans être représentées par des spécialistes, la géographie est présente. Mais on ne la trouve pas seulement là où les auteurs la mentionnent. Il ne s’agit pas de reprocher des erreurs ou des manques. Certes la contribution des géographes aux études sur la forme urbaine ne se limite pas aux «Types de peuplement rural en France» d’Albert Demangeon (p. 210). Mais il est plus intéressant de voir que les auteurs ont un parti géographique non formulé comme tel et, surtout, que ce parti géographique correspond à une orientation incomplètement explicitée bien que fondamentale de cette recherche. Même si les géomaticiens et les physiciens de l’équipe s’efforcent de l’abstraire de toute interférence avec chaque contexte urbain d’étude, leur modélisation de la spatialité des rues comporte une modélisation du social. Cette dernière apparaît quand Claire Lagesse cherche, dans ses calculs de structuralité des voies, à maîtriser la variable «acteur». Une voie est une ligne continue caractérisée par une «volonté impliquée [qui] reste la même» de la part de l’individu qui l’emprunte (p. 156). Elle peut ainsi prendre la forme d’une perspective ou d’un tracé moins linéaire, mais balisé. Le but est de discriminer les «vrais» tournants qui, parce qu’ils ont un coût pour l’individu (ils impliquent une volonté particulière) permettent d’identifier les voies les plus structurantes, celles qui comportent un grand nombre d’intersections où les individus doivent faire des choix.
Cette construction ne se limite pas, comme on le voit, à la stricte spatialité. Le social y prend l’allure d’individus sans interaction entre eux, mais en interaction visuelle avec leur environnement, en mouvement ou plus exactement en avancée continue («l’acteur avance dans une ligne de perspective ou dans un tracé balisé», p. 156). Les variations de métriques n’ont pas d’implication sur la mesure de la «volonté» de l’individu, et les raisons de ces variations ne sont pas prises en compte. C’est ce que nous désignons comme un parti géographique, une façon parmi d’autres d’appréhender l’espace des sociétés humaines. Et en ce sens, la voie conçue par les géomaticiens est assurément un «objet géographique» (p. 152). Mais ce parti géographique ne peut qu’être interpellé par les objections méthodologiques posées à partir de l’étude de cas finale sur Kyoto (Philippe Bonnin et Estelle Degouys, p. 251-255).
Le réseau collaboratif OSM (Open Street Map) [une des sources utilisables pour la modélisation des voies d’une ville] réalisé bénévolement par véhicule à moteur probablement, s’arrête avant les ruelles piétonnes, et ne peut interconnecter les venelles et roji à l’intérieur des îlots. Ce sont pourtant bien ces voies que les habitants parcourent pour accéder à leur demeure. […] Se pose une question importante: de quelles voies parle-t-on? Quelles voies étudie-t-on? Les seules voies automobiles qui intéressent les industriels actuels? Les voies que peuvent emprunter les vélos? Toutes les voies que peuvent emprunter les piétons depuis que les villes existent (y compris les escaliers et ruelles étroites)? Dans le contexte du développement durable, c’est-à-dire aussi dans la prise en compte du temps long qui est celui de la fabrication des villes et de leur réseau viaire, c’est le réseau piétonnier qui importe le plus. Il nécessite alors un regard critique sur les données disponibles, et une confrontation avec la réalité du terrain (p. 251).
Il faut remercier les auteurs de donner à lire et à voir une interdisciplinarité en actes autour des réseaux, les pistes qu’elle ouvre, les tensions qu’elle contient. Malgré des objections concernant la forme (quelques productions difficilement lisibles [2] quelques études de cas non problématisées), cet ouvrage à la construction originale est d’une lecture stimulante.
Référence de l’ouvrage
DOUADY C.-N. et l’équipe Morphocity (2014). De la trace à la trame. La voie, lecture du développement urbain. Paris: L’Harmattan, 255 p. ISBN: 978-2-343-04232-9
Bibliographie
BEAUGUITTE L. (coord.) (2014). Croissance et décroissance des réseaux. Actes de la troisième journée d'étude du groupe fmr, 140 p. halshs-01068589
BERTHELOT J.-M. (coord.) (2012). Epistémologie des sciences sociales. Paris: PUF, Coll. « Quadrige Manuels », 593 p.
ISBN: 978-2-130-60724-3